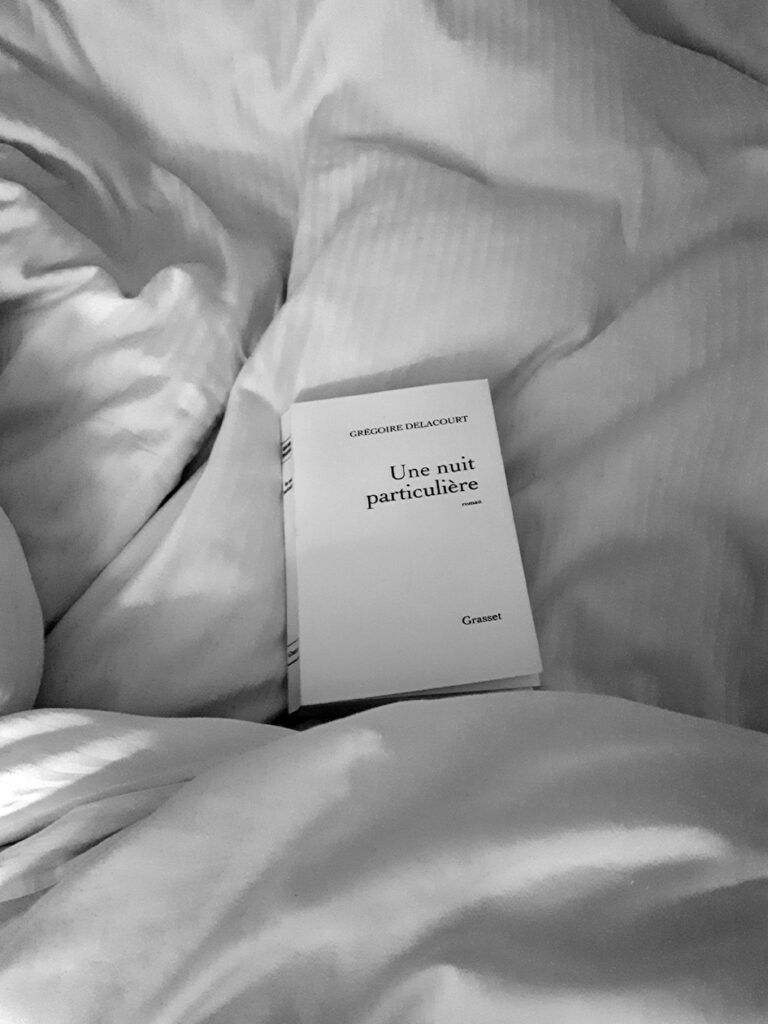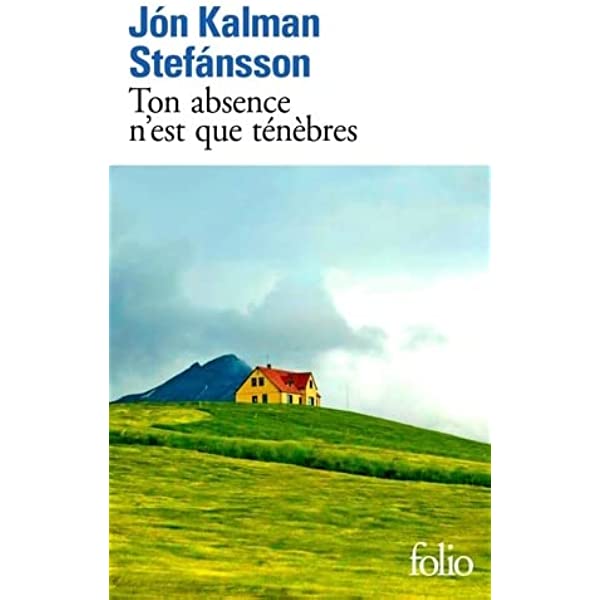
Flanage de lecteur inoccupé autour des riches tables de la librairie des Arcenaulx, place Estienne d’Orves à Marseille. Un premier tour ne produit aucun résultat. Un second tour me fait retourner quelques livres. Je lis en diagonale leur 4e de couverture avant de reposer les volumes, inconvaincu. Impression d’indifférence ou d’avoir déjà lu quelque chose comme ça, raconté par quelqu’un d’autre. Il y a des jours où l’on a déjà lu tous les livres. Au troisième tour, je balaie d’un regard blasé la sélection des livres de poche. Pas de frémissement. Tout de même, un nom retient mon attention : Jón Kalman Stefánsson. Ma main se tend. Le titre m’arrache un soupir : Ton absence n’est que ténèbres. Ça promet ! Deuxième soupir : le livre fait 600 pages. Épaisses les ténèbres ! Longue l’absence ! L’auteur est islandais. La 4e de couverture m’informe que cela parle d’un voyageur amnésique que tout le monde connaît loin de Reykjavík à l’ombre du Snæfellsjökull, dans les fjords perdus de l’ouest de l’Islande. Les récits se tissent en fresque de la vie islandaise du XIXe siècle à nos jours. Le livre a obtenu le prix du Livre étranger France Inter- Le Point 2022. « Qui sommes-nous, comment aimer, comment mourir » conclut sobrement la note de présentation de l’ouvrage. À ma grande surprise, après avoir lu cette épitaphe, je ne repose pas le bouquin, je le conserve, je paie, j’emporte. Je lis. Et dès les premières pages, je sais que c’est un bouquin formidable qui va m’entrainer là où justement, j’ai envie d’aller.
Jón Kalman Stefánsson est un auteur de premier plan, connu et traduit dans le monde entier, qu’ils disent sur wikipedia. Il était grand temps que je le découvre, il est déjà en livre de poche !

Jón Kalman Stefánsson est un poète. Il me rappelle la tendresse irrésistible et le sourire communicatif de Richard Brautigan. Un Brautigan islandais qui sait merveilleusement parler de nous. Toucher notre moi intime. Avec lucidité, ironie et délicatesse. Des femmes. Des hommes. De l’amour et forcément de la mort. À l’âge des voyages à cheval et à l’heure de Google. Avec des parfums de terre minérale, de racines profondes, de marées, de vents et inévitablement de brebis. Il y a aussi beaucoup de musique. La playlist figure à la fin du livre. Comme l’écrit Valérie Marin La Meslée, journaliste littéraire au service culture du Point : « Ce livre est si éblouissant, tendre et beau qu’on voudrait ne l’avoir jamais fini. » Peut-être, si on veut. On est en excellente compagnie. On sort vivifié et reminéralisé de sa lecture. Ce n’est pas si fréquent. Une fois refermé le roman, rien n’empêche de le passer à un autre voyageur.